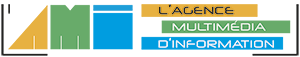5 juillet 2016
Deux regards ; deux horizons

Du 29 juin 2016 au 16 janvier 2017, galerie 3, le centre Pompidou de Metz et le Saarlandmuseum proposent de façon appliquée l’exposition “Entre deux horizons”.
METZ – Projet de collaboration transfrontalier inédit, l’exposition “Entre deux horizons” raconte plus de cent ans d’une histoire partagée ; celle des influences croisées, des consonances et des dissonances artistiques entre la France et l’Allemagne. Le parcours se compose d’environ 230 peintures, sculptures, estampes et photographies du Saarlandmuseum, complétées par une importante documentation, essentiellement issue des fonds de la Bibliothèque Kandinsky du centre Pompidou. La nouvelle région Grand-Est, en France, fut jadis “la” pomme de discorde franco-allemande. Ici, se renvoient l’écho de ces conflits dans les perceptions intimes des artistes à la fois si proches géographiquement et si éloignés intellectuellement.
Deux voie parallèles
S’il est vrai que les fonds étrangers des musées d’un pays sont le miroir des relations diplomatiques qu’il entretient, les avant-gardes allemandes du début du XXe siècle sont sous-représentées, voire quasiment absentes des collections françaises pour des raisons historiques. La défaite française, à l’issue de la guerre franco-prussienne, engendre en 1871, la naissance de l’État-nation allemand. L’époque est aux nationalismes et à l’affrontement, des deux côtés du Rhin et pendant des décennies le domaine artistique n’y fait guère exception. Car, pour une partie des politiques, des intellectuels et mêmes des artistes, c’est précisément par oppositions idéologiques que se définissent les deux cultures voisines de la fin du XIXe siècle et pendant une bonne partie de la première moitié du XXe siècle.
L’exposition “Entre deux horizons” propose sagement une lecture chronologique de cette histoire complexe jusqu’à l’ère contemporaine. Installée près de la frontière franco-allemande, la collection du Saarlandmuseum recèle de véritables chefs-d’œuvre issus des deux rives du Rhin. Elle se prête donc à la découverte de cette histoire et de grands mouvements de l’art qui, comme l’expressionisme allemand, s’avèrent souvent ignorés des musées français. Au cours du XIXe siècle, la Sarre fut séparée à deux reprises pendant plusieurs années de l’Allemagne pour être associée à la France. Cela à la suite de la Première puis de la Seconde Guerre mondiale. Au sein de la collection, l’une des plus importantes du sud-ouest de l’Allemagne, se côtoient les tableaux impressionnistes d’Auguste Renoir et de Max Liebermann ; le “fauve” André Derain fait face aux peintures et gravures flamboyantes des expressionnistes Ernst Ludwig Kirchner et Emil Nolde. La collection retrace également le dialogue fertile entre Robert Delaunay et les membres du collectif Der Blaue Reiter, dont Franz Marc et August Macke ou encore l’amitié malgré la guerre de Fernand Léger et Willi Baumeister. À partir de 1952, époque où la Sarre est tout d’abord, en tant qu’État autonome, placée sous protectorat français avant d’être réintégrée en 1957 à la nouvelle République fédérale d’Allemagne, l’Abstraction lyrique française fait, avec Roger Bissière, Serge Poliakoff et d’autres, tout comme l’Art informel allemand, son entrée dans la collection. Aux protagonistes du groupe “ZERO” et du Nouveau Réalisme, succède une mise en perspective contemporaine d’artistes tels que Damien Deroubaix et Jonathan Meese.
Un, deux, trois…
Pour autant, ici, le discours comme la présentation peut sembler sévère. Le centre Pompidou de Metz nous avait habitués à des présentations plus ludiques. On est là dans le sérieux, l’im-pé-cable ! Presque dans le sévère. Comment comprendre en sortant de là cette impression de danser avec un compagnon ou une compagne qui murmure à votre oreille : “Un, deux, trois… Un, deux, trois…”, pour accompagner le mouvement sans jamais s’abandonner à la magie de la danse et du contact. C’est pédagogique. Certes… Sérieux. A n’en pas douter… Strict… Presque. Académique… Trop ! Cela alors que c’est un peu vite oublier que les artistes présentés ici étaient dans une autre logique, une autre vie, un autre délire, dans des visions assez loin de ce conformisme orthodoxe perceptible dans cette exposition. Le parcours creuse-t-il encore, dès lors, le fossé qui existe entre la vision et le concept de la représentation artistique nord européenne face à ceux des pays latins ? C’est ce qui apparaît. Et c’est justement cela qui est intéressant ici.
JEAN-PIERRE COUR
Quatre sections
Le parcours de l’exposition, par salles successives, va de 1870 à nos jours.
• La Section 1, “Une paradoxale suprématie (1870-1904)” montre l’impressionnisme et l’influences françaises au tournant du siècle représenté par ces artistes novateurs dans un espace que leur refusent les structures officielles, dépendant de l’État.
• La Section 2, “Tempête, révolutions et avant-gardes (1905-1925)”, parle de l’Expressionnisme et du fauvisme avec August Macke (1887-1914) ou André Derain (1880-1954) ; du cubisme avec Georges Braque et Pablo Picasso ou encore ici Albert Gleizes (1881-1953). Là, l’arrivée de la guerre exacerbe les nationalismes et les propos bellicistes des intellectuels, y compris des artistes. L’on découvre dans cette section, outre ceux qui sont opposés à la guerre (la revue Die Aktion, Ludwig Meidner, Romain Rolland, Hermann Hesse), ceux qui considèrent que servir la patrie est un devoir (Charles Péguy, les tenants de la revue Der Sturm) et ceux que cette perspective exalte (Apollinaire, Thomas Mann, Henri Bergson).
• La Section 3, “Stupeur, exils intellectuels (1926-1945)”, expose la guerre considérée comme absurde et vue comme une révolution ratée, mais aussi le malaise d’un présent à la dérive ; forces motrices d’une profonde mutation de l’art en Allemagne. Là, le contexte politico-économique désastreux de l’Allemagne des années 1920 finit d’anéantir les aspirations humanistes d’avant-guerre et appelle à une représentation plus pragmatique de la société selon une “Nouvelle Objectivité”. En 1919 naît sous l’impulsion de Walter Gropius une école d’enseignement artistique d’un nouveau genre, le Bauhaus. On concentre dorénavant l’attention sur la fonction et l’implication sociales de l’art dans le but de créer un environnement esthétique nouveau, respectueux de l’homme à l’ère industrielle. L’art n’y est pas une discipline autoréférentielle mais doit modifier les formes utiles de la vie quotidienne. Ce fonctionnalisme s’exprime dans tous les domaines de la création industrielle. Hérité de l’esprit de révolte initié par Dada, le surréalisme rejette quant à lui la logique rationaliste qu’il juge co-responsable de la guerre. Entre la signature des accords de Locarno en 1925 et l’arrivée au pouvoir du Parti national-socialiste en 1933, la France s’ouvre timidement aux idées venues d’outre-Rhin. Ces échanges cessent brutalement avec l’arrivée au pouvoir du régime hitlérien.
• La Section 4, “Abstractions. Rapprochement et éloignement (Après 1945)”. Ici la France s’appuie sur la politique culturelle afin d’œuvrer à la rééducation démocratique du peuple allemand. Or, le public allemand attend plus encore le rendez-vous avec ses propres avant-gardes artistiques, anémiées et bannies comme dégénérées. Enthousiasmés par l’art immatériel d’Yves Klein, ainsi que par son refus de l’informel, Heinz Mack et Otto Piene fondent le groupe “ZERO” en 1957 à Düsseldorf. Günther Uecker s’y rallie 1961. Ils aspirent à un monde de clarté et de dynamisme, lumineux et pur, offrant un contrepoint à l’aspect parfois sombre de l’art informel. Pour autant, l’héritage pictural et spirituel des fauves comme des expressionnistes est indéniablement perceptible dans l’œuvre d’artistes contemporains tels que Damien Deroubaix, lui-même artiste “entre deux horizons”, installé près de la frontière franco-allemande, ou Jonathan Meese.
J-P.C
Photo : © J-P. C. Der Sturm – La Tempête : “Der Sturm – La Tempête, revue fondée par Herwalth Walden qui accompagna une galerie soutenant les artiste expressionnistes”.